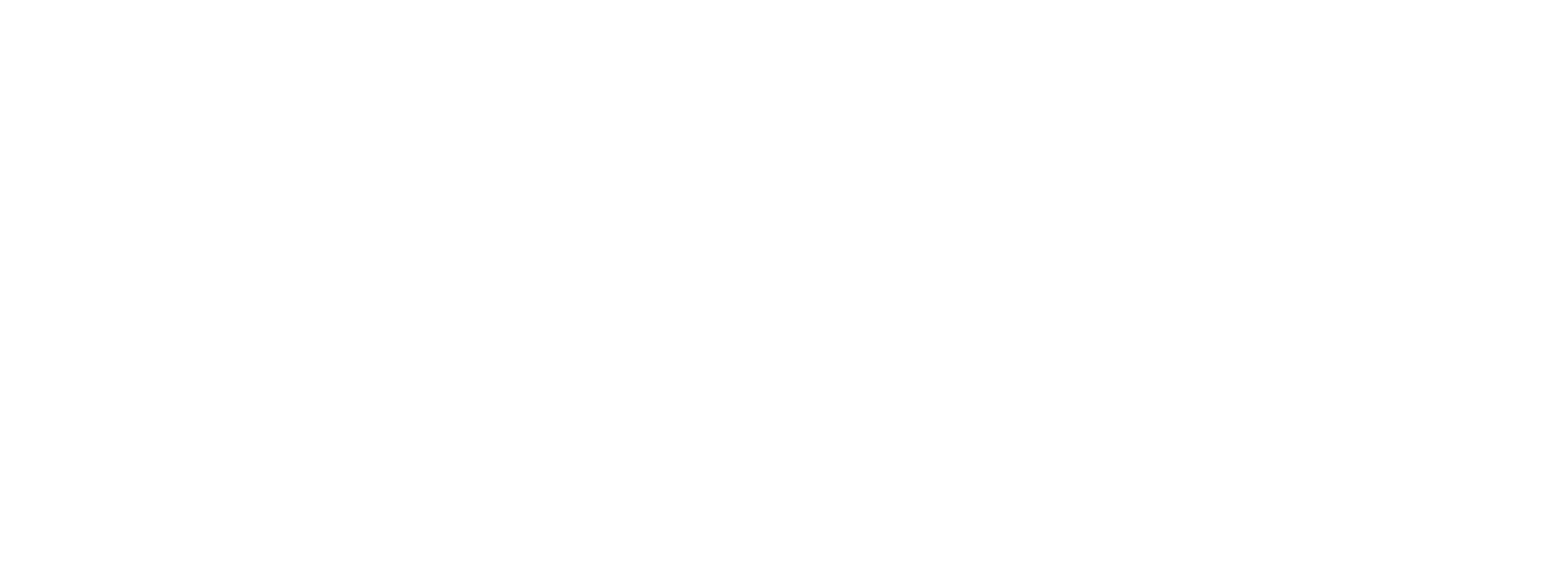Blanche a 24 ans, son confinement a quelque chose d’unique. Pour elle, c’est une prolongation d’une situation qu’elle connaissait déjà de manière intime et angoissante. Malgré tout, le message qu’elle partage est formidable d’espoir.
Pour moi, le confinement a un goût amer. Pas parce qu’il me sort de mon quotidien mais, au contraire, parce qu’il est présent depuis trop longtemps. Le matin du 12 mars, on m’a annoncé la rémission de mon cancer. Le même 12 mars, au soir, le pays se mettait partiellement à l’arrêt. Physiquement et psychologiquement, je m’étais préparée à sortir à nouveau en commençant un service citoyen(*) afin de retrouver un rythme quotidien. Aujourd’hui, j’ai l’impression que tout le monde s’est adapté au mien.
Il y a encore un mois, la connotation du verbe « sortir » était pour moi source d’angoisses. Le monde extérieur était devenu un lieu hostile, un terrain de jeu potentiel pour mes crises de spasmophilie, vertiges et autres joyeusetés, toutes des conséquences de mes traitements hormonaux. Sortir seule ressemblait alors à un fantasme, la faute à mes cognitions négatives et obsessionnelles qui me criaient que sortir, c’était prendre un risque. Changer ces cognitions en démarrant un service citoyen m’a demandé beaucoup d’efforts et j’ai peur que cette obligation de confinement les réduisent à néant.
Des psychologues estiment qu’une durée de confinement de plus de dix jours est prédictive de syndrome post-traumatique. Des numéros verts spéciaux pour le corona se sont donc mis en place mais, parfois plus forte que les angoisses intérieures, il y a l’angoisse téléphonique, et aussi souvent la sensation qu’on n’est pas légitime ou qu’on n’a pas assez de raison de demander de l’aide. Mais il n’y a jamais de mauvaise raison, elles se valent toutes. J’ai eu un épisode dépressif qui a été bien plus dur à vivre que toutes les douleurs physiques que j’ai connues. Ce que j’en ai retenu, c’est que nous ne sommes pas responsables de notre détresse psychologique.
Je pense à ceux qui souffrent du confinement, pour une raison ou pour une autre, que ce soit les personnes autistes qui doivent adapter leurs habitudes, ceux qui subissent la violence de leur conjoint ou de leurs parents, ou encore ceux qui subissent une addiction renforcée par la situation. Je pense à tous ceux qui culpabilisent de retomber dans de mauvais travers, de prendre des médicaments pour dormir, de ne pas travailler assez ou de ne pas profiter du confinement pour apprendre le grec ancien.
Je voudrais qu’ils puissent déculpabiliser, et moi avec. Chercher à vivre, avec ou sans aide (médicamenteuse ou humaine), mais vivre, malgré tout. Malgré les angoisses qui persistent, malgré le chagrin et la peur. Vivre malgré le confinement, les non-sens politiques, les cognitions négatives. Vivre malgré les deuils et la solitude. Vivre pour ne pas mourir, périr, pourrir. Vivre avec des anxiolytiques, de l’alcool, du chocolat, des antidépresseurs s’il le faut. Nous avons le droit d’être en détresse, d’être faible, d’être paresseux ou anxieux. Je fêterai mes 25 ans dans un mois, confinée et sous anxiolytiques s’il le faut. On n’est pas surhumain, on ne doit pas l’être. Humain, c’est déjà très bien.
(*) Le service citoyen est une expérience de vie, exceptionnelle, proposée aux jeunes de 18 à 25 ans. Durant six mois, ils prennent le temps de s’engager dans une structure, une association solidaire, tout en réfléchissant à de quoi demain sera fait.
![]() A écouter aussi en podcast ici
A écouter aussi en podcast ici