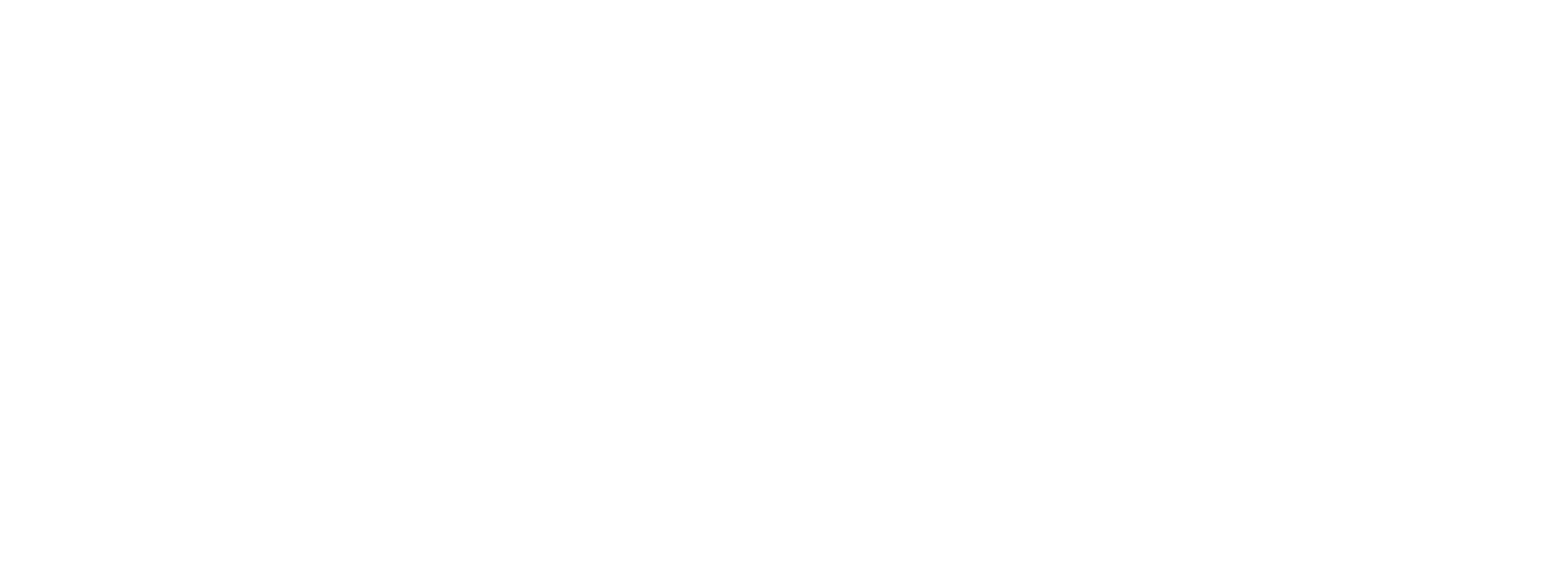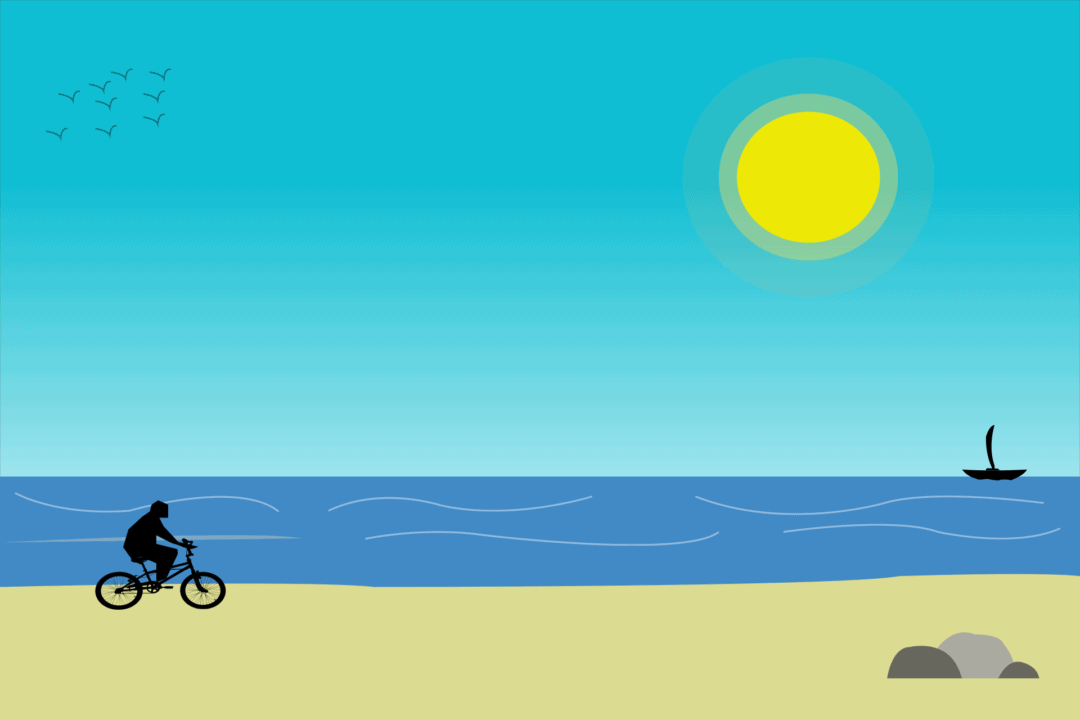Imaginez que vous marchez sur une plage de sable fin, comme on en trouve à Ostende. Vous marchez et, en vous retournant, vous vous apercevez qu’un seul de vos pieds – disons le gauche – laisse une empreinte. De l’autre, pas de trace. Évidemment, puisqu’il est là, solidement articulé au bout de votre jambe, tout porte à croire qu’il a dû, qu’il aurait dû, lui aussi, imprimer dans le sable sa marque, alternée avec celle de son controlatéral. Et pourtant, rien. La trace continue d’un pied, d’un seul pied, comme si la mer avait mangé l’autre, comme si le droit n’avait jamais existé.
La situation semble incongrue et mentalement inconfortable, n’est-ce pas ?
Elle est pourtant l’image de ce que peut encore ressentir aujourd’hui un jeune Belge comme moi, issu de la dé٠colonisation, descendant de colons et de colonisés.
J’ai toujours vécu à l’ombre de cet arbre généalogique manchot, à la branche sciée, sans me poser de questions, sans me demander pourquoi tout le monde était blanc sauf mon papa.
Bien sûr, on m’avait raconté l’histoire : 1950, l’après-guerre, la faillite du commerce familial, l’école coloniale et le départ pour le Congo, les aventures toutes véridiques mais néanmoins incroyables comme un album de Tintin, la plantation, l’indépendance, la guerre, la fuite par le lac, le retour à Liège avec un fils : mon futur père. Cette histoire, mon papy me l’a racontée et, j’ai tout cru, tout gobé sans me poser de questions, puis en m’en posant : qui était ma grand-mère ? Pourquoi elle n’est pas venue avec toi ? Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés ? Je ne les posais pas tout haut, parce que je savais déjà que c’était compliqué, que personne ne voulait vraiment savoir, que personne ne voudrait vraiment répondre. Parce que ce n’était qu’une petite histoire de famille sans importance. Parce que c’était mon grand-père, qu’il nous aimait et qu’il ne pouvait pas être le méchant.
À l’école, j’aurais voulu trouver moins de pudeur, j’aurais voulu qu’on me raconte cette histoire sans détour, avec plus de détachement, sans voile. J’aurais voulu avoir des professeurs que les liens du sang n’empêchent pas de répondre aux questions gênantes. Mais là encore, je n’ai retrouvé que la mythologie à peine actualisée d’une Afrique sortie du néant le jour de la Conférence de Berlin, d’une colonisation certes débattue, parfois contestée mais entre parlementaires, à Bruxelles et toujours vue exclusivement d’Europe. Jamais un mot sur ce qu’en ont vu, vécu, souffert les colonisés. Jamais un mot ni sur les royaumes Bantous, ni sur les esclavagistes ni sur rien de ce qui a pu se passer dans cette terra incognita. Pourtant, tout ce travail de critique, qu’on a fait en classe pour l’Amérique du Sud, qu’est-ce qui nous empêche de la faire pour le Congo ? Est-ce un manque de distance qui nous fait rejouer chaque année le jeu de la poutre et de la paille ? Est-ce qu’il faut attendre le décès de toutes les générations d’avant 1960 pour regarder dans le rétro ?
Aujourd’hui, je me pose encore les questions, et je n’ai pas plus de réponses, mais je suis sûr, désormais, que je ne suis pas le seul à me les poser ;
sûr que mon histoire n’est qu’une des variations infinies de la même Histoire de la colonisation ;
sûr que ce n’est qu’un fil parmi les milliers qui forment cette grande tapisserie ;
sûr que mon arbre généalogique élagué en cache une forêt.
C’est pourquoi je voudrais que la Belgique d’aujourd’hui et ses institutions abandonnent cette vieille fable d’une colonisation toute bienveillante et bénéfique, à ne pas rester sourde et aveugle à la juste colère exprimée contre l’injustice brutale faite à tout un continent et à rechercher, et à reconnaître, et à enseigner honnêtement la vérité de cette époque qu’on ne veut pas voir.
Auteur : Laurent, 32 ans, Liège
CET ARTICLE A ÉTÉ PRODUIT LORS D’UN ATELIER SCAN-R.